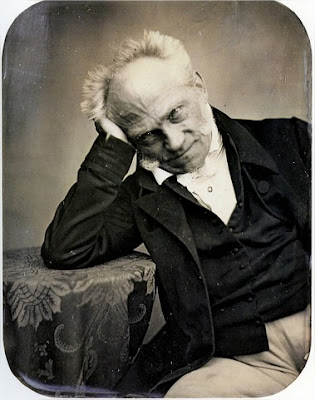Un grand bravo à Romane et Simon qui ont disputé un match très serré ! Romane remporte deux points et Simon trois points. Je félicite leur assiduité !
Le texte que vous avez pu entendre hier soir est un extrait de Bel-Ami. Ce roman, le second écrit par Maupassant, a d'abord été publié en feuilleton dans le journal Gil Blas puis édité la même année, en 1885, chez l'éditeur Havard.
 |
| Première édition de Bel-Ami chez l'éditeur Havard en 1885. |
Cette œuvre raconte le parcours de Georges Duroy, un jeune Normand sans scrupules venu à Paris pour réussir à tout prix et gravir les échelons de la société ainsi que du pouvoir. Sans talent particulier mais avec un physique de séducteur, cette "graine de gredin", ainsi que l'appelait Maupassant, parvient à se hisser au plus haut niveau, grâce aux femmes qu'il conquiert et qui servent l'une après l'autre son ambition...
 |
| Monsieur Louis Pascal, Henri de Toulouse-Lautrec, 1891. Ce tableau est souvent utilisé comme première de couverture de certaines éditions de Bel-Ami. |
Gravir les échelons, se hisser au plus haut... la montée des marches décrite dans le texte d'hier, que vous pouvez relire ici dans son intégralité (1), symbolise à ce titre la réussite future de Georges Duroy, et annonce la puissance des apparences qui permettra au personnage d'"arriver". Dans cet extrait, situé au début du roman, Duroy n'a pas encore reçu le surnom de "Bel-Ami", mais il prend conscience de son pouvoir de séduction avant de faire sa première entrée dans le monde, chez Charles Forestier, un journaliste influent dont il épousera plus tard la femme...
 |
| Illustration du roman par Ferdinand Bac pour l'éditeur Paul Ollendorff en 1894 |
Si vous souhaitez écouter d'autres passages de Bel-Ami ou en apprendre davantage sur ce roman, vous pouvez suivre intégralement l'émission d'où provient l'extrait d'hier :
Chaque samedi, sur France Inter, le comédien Guillaume Gallienne anime l'émission "Ça peut pas faire de mal", dans laquelle il lit des extraits d’œuvres littéraires. Je vous en recommande l'écoute régulière (2)...
A l'automne 2015, trois émissions ont été consacrées à Guy de Maupassant. En classe nous écouterons très bientôt d'autres textes extraits de cette trilogie.
A très vite !
(1) La version Open Dyslexic est disponible là.
(2) Sans transition : s'il y a des amateurs de la saga Harry Potter, l'émission de samedi dernier (le 24/12/16, donc...) était consacrée au plus célèbre des sorciers à lunettes...